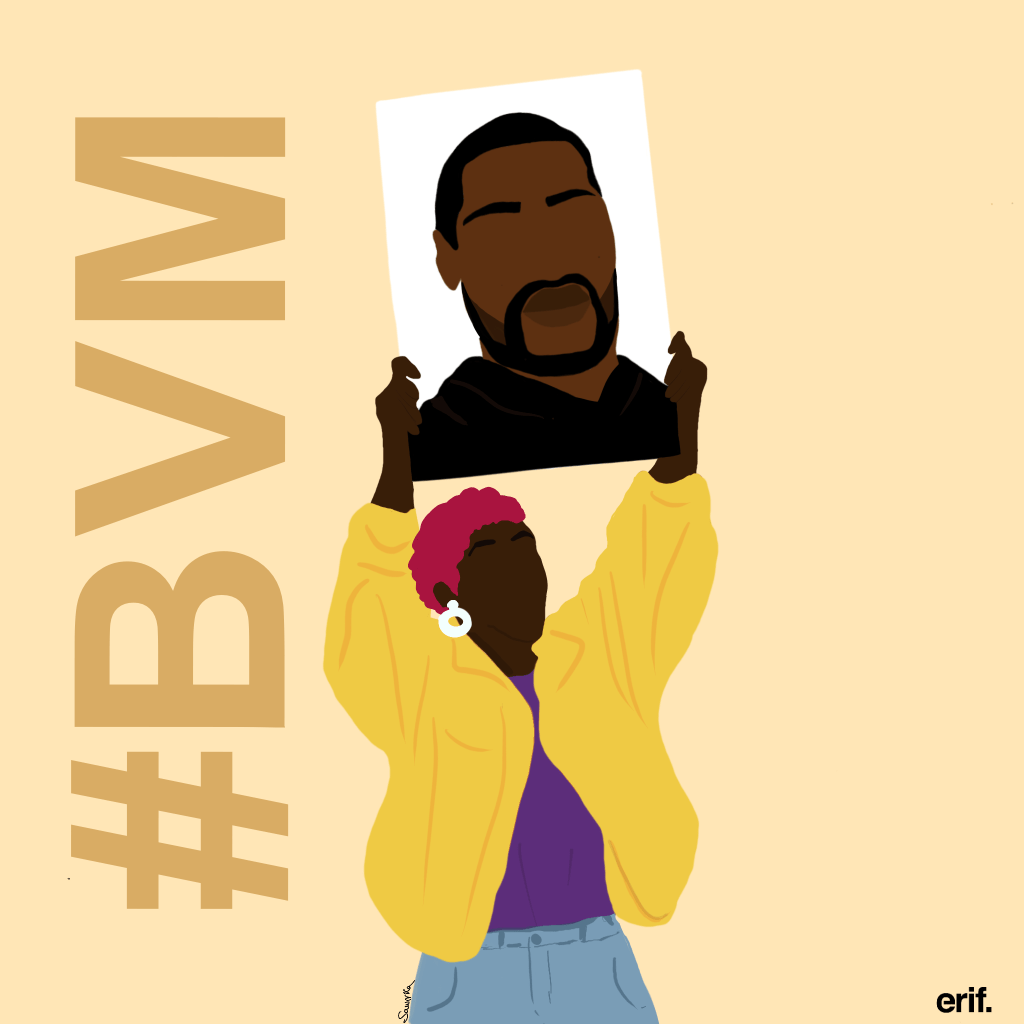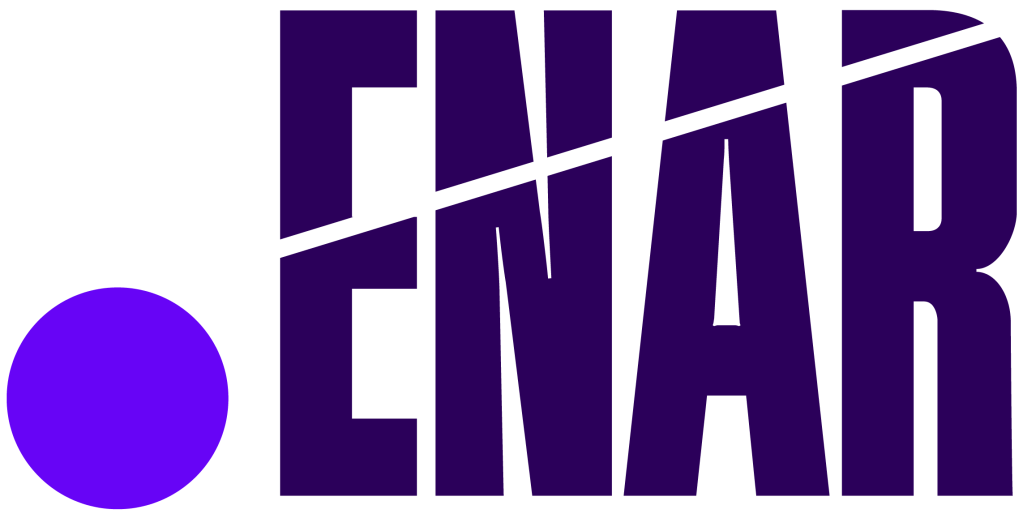par Noémi Michel
English I French
« Je cherche les mots justes, ceux qui pourraient venir orienter une relation non-morbide à la multitude de vies noires injustement interrompues ». Appréhendant le poids du capitalisme racial et son désir pour la mort des Noir.e.x.s, Noémi Michel nous offre une réflexion qui oscille entre mélancholie et espoir.
« T’as remarqué que personne ne dit rien ; si cet homme avait des enfants, une femme, un frère, une sœur. Tout le monde est tellement concentré sur sa mort et personne ne dit rien sur comment il a vécu. C’était un frère qui a été tué devant une caméra pour que le monde entier voie, et cela me fait me sentir d’une certaine manière »
Hollywood, Queen Sugar, saison 5, épisode 6 (traduction de l’auteure)
Été 2021. Je suis confortablement installée dans mon canapé chez moi. Je visionne la saison 5 de Queen Sugar, une de mes séries préférées, une saga familiale au long cours qui thématise l’accès des Noir.e.x.s à la propriété foncière et à la production agricole dans l’État de Louisiane hanté par l’histoire de la vie réduite en esclavage dans les plantations. Depuis le lancement de cette série en 2016, je suis une fidèle spectatrice. J’adore la regarder avec du popcorn. J’aime la beauté des personnages et des paysages, la profondeur et la complexité de leurs relations, la musique (composée par Meshell Ndegeocello), la photographie qui sublime une variété de beautés noires. Mais la saison 5 est vraiment intense. Ses scénaristes ont décidé de la faire résonner avec l’année écoulée, à savoir avec les débuts de la pandémie du Covid 19 et les soulèvements pour les vies noires. Visionner l’épisode 6 me fait ainsi revivre le mois de mai 2020, l’horreur de l’assassinat raciste commis par le policier Derek Chauvin à l’égard de George Floyd. A l’écran, les personnages expriment leur choc, leur colère et leur tristesse, ont des conversations soutenues, et se mobilisent dans la rue. C’est réaliste et dur, mais je ressens aussi du réconfort. Pour une fois, mon écran m’offre un espace d’alignement politique et émotionnel. Je me sens alignée avec Darla, qui s’inquiète des conséquences du traitement médiatique du lynchage policier sur son jeune fils : « ils ne devraient pas passer la vidéo en boucle, c’est traumatique », dit-elle à son compagnon Ralph Angel. Je me sens réconfortée de voir Hollywood, un homme noir d’une cinquantaine d’années exprimer son désir de savoir « comment [George Floyd] a vécu » dans un dialogue avec sa compagne, Vi (Image 1).
Le visionnement de cet épisode me fait réaliser que je n’ai que très rarement rencontré le nom « George Floyd » accolé au mot « vie » dans le contexte des médias et des discours publics mainstream. La vidéo virale de son lynchage a donné place à une expression tout aussi virale : « la mort de George Floyd ». Cette expression peuple la toile, les médias, les discours politiques et académiques. Elle est utilisée dans de multiples langues et contextes de par le monde. Elle remplit une double fonction. Premièrement, elle fonctionne comme un marqueur temporel. Elle vient nous signifier que nous nous trouvons dans un nouveau temps politique et historique, qu’il y a eu un avant et un après mai 2020. Souvent précédée par les prépositions « depuis », « après » ou encore « post », elle signale un tournant, cet instant t qui a déclenché des soulèvements, des statues mise à terre, des demande d’abolition de la police, des débats intense sur le racisme et les héritages coloniaux. Deuxièmement, l’expression fonctionne comme formule de légitimation. Utiliser le nom d’une victime du racisme globalement connue et reconnue permet de donner du poids à son propos. L’usage de l’expression donne de la pertinence aux demandes de fond, au descriptif d’événement se réclamant de l’« antiracisme », allant du plus libéral au plus radical, que ce dernier soit porté par des personnes non-noires ou noires au sein ou en dehors des institutions. En somme, depuis 2020, les différentes variantes de l’expression « la mort de George Floyd » constituent une forme de capital. Dire ou écrire « après George Floyd », « depuis la mort de George Floyd » ou encore « à l’ère post-George Floyd » permet de se situer dans l’air du temps, de se caractériser comme un individu ou un groupe porteur de demandes de haute importance et urgentes. L’utiliser permet d’attirer de l’attention publique et des ressources matérielles.
L’expression marche bien. Mais je m’interroge sur les effets de son usage. Comment nous met-elle en relation avec les vies noires ? Que se passerait-il si tout le monde disait plutôt : « depuis l’assassinat suprémaciste blanc par l’officier de police Derek Chauvin et ses complices ? » ou depuis « le soulèvement global radical noir de 2020 » ? L’expression semble nourrir une obsession publique pour la mort noire, qui à l’instar de Hollywood, me fait me « sentir d’une certaine manière ». Par ce texte, je cherche à donner de l’espace à ce sentiment de trouble et aussi à ce qui anime ce désir de savoir comment George Floyd et tant d’autres ont vécu. Il s’ancre dans la pensée et l’activisme féministes noires centrés sur le soin de la vie.
Capitalisme racial et désir pour la mort des Noir.e.x.s
« Le racisme, en particulier, désigne la production et l’exploitation par l’État et/ou extra-légale d’une vulnérabilité à la mort prématurée, différenciée selon les groupes »
Ruth Gilmore Wilson, 2007 Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California, University of California Press, p. 28 [1].
Automne 2012. Je participe à la conférence Decolonize the City à Berlin [2]. Je suis dans le public et me retrouve exposée pour la première fois aux mots puissants de la féministe noire abolitionniste Ruth Gilmore Wilson. Sa définition du racisme me frappe : le racisme est une politique qui produit la mort prématurée des groupes racialement infériorisés. Pour comprendre sa citation, il faut la resituer dans la pensée critique du capitalisme racial. Révisant l’eurocentrisme des marxistes classiques, Ruth Gilmore Wilson et Cédric Robinson, parmi d’autres, rappellent que le capitalisme est un système global intimement lié au suprémacisme blanc. Il s’est institué par une accumulation de valeur marchande rendue possible par la traite, l’esclavage et le colonialisme. Et il continue d’opérer par la hiérarchisation et la domination raciales. Il permet aux groupes et territoires marqués comme « blanc » – et donc comme racialement supérieurs – d’accumuler systématiquement des ressources matérielles et symboliques en opprimant les groupes et territoires considérés comme racialement inférieurs, à savoir comme moins-humains, ou non humain. Une telle exploitation déshumanisante, insistent les marxistes noir.e.x.s, va au-delà de l’aliénation par le travail. Elle fonctionne par la mort sociale, à savoir par la dispersion de la communauté, des liens de parenté et la mutilation du corps. Elle entraîne la mort physique prématurée. Le racisme c’est la mort.
Le racisme c’est aussi le désir pour la mort, pour la mort des Noir.e.x.s. C’est ce que me font comprendre mes lectures assidues d’auteures féministes noires telles que Saidiya Hartman, Toni Morrison, Grada Kilomba, Hortense Spillers ou encore Jovita dos Santos Pinto. Elles insistent sur la dimension affective et libidinale du capitalisme racial. Ce dernier, suggèrent-elles, fonctionne comme une machine à profit qui dépend de la création incessante de désirs consuméristes [3]. La logique du profit et de l’accumulation capitaliste requiert que le public désire consommer un maximum de biens dont la production se fait par l’oppression, à savoir par des opérations d’exploitation qui consument la vie de celleux qu’elles affectent. Or, cette oppression mortifère, il faut la vendre, il faut la rendre désirable au public qui en bénéficie, ce par le biais d’opérations de divertissement. Dans les sociétés occidentales, le public blanc apprend ainsi à consommer les biens issus de l’exploitation (post)coloniale tels que le sucre et les épices, le cacao ou encore le café. Il apprend dans un même mouvement à prendre du plaisir à assister à des spectacles qui moquent, violentent et mettent à mort les Noir.e.x.s. Il se divertit par les minstrel shows, l’exposition dans des zoos humain, des freak shows ou des films, ou encore de lynchages publics, s’abreuve du voyeurisme de corps nus, hypersexualisés, « sauvages » et « exotiques ». Le capitalisme racial capture la force vitale à l’origine des désirs et l’oriente vers le sentiment de puissance et de plaisir que procure la consommation d’objets (vivants ou non) dont le destin est de se consumer. Il invente et propage une blanchité vampiriste, désireuse de profiter de Noir.e.x.s-objets, en position éternelle de servitude ou de service, à disposition, mais aussi jetables, déchettisables, violables et tuables. Le racisme c’est le désir pour la mort des Noir.e.x.s.
C’est cette histoire – encore bien vivante – de la liaison fondamentale et intime entre le désir pour la mort noire et le capitalisme racial qui hante l’expression « Mort de George Floyd ». L’expression marche bien car elle capitalise sur le désir structurel pour la mort prématurée des Noir.ex.s. Elle marche bien également, car elle dissimule le passé et le présent morbide qui la hantent. Son utilisation virale, souvent peu contextualisée, fait oublier que la mort dont il est question, loin d’être exceptionnelle ou accidentelle, est ce que le système global capitaliste et blanc suprémaciste fait désirer. L’expression suggère l’horreur tout en effaçant l’histoire, tout en évacuant de la vue les processus et les instances qui ont rendu cette horreur possible. C’est pour cela que l’expression me fait me sentir d’une certaine manière. Elle scelle un nom à sa mort physique tout en évacuant les causes historiques et politiques de cette dernière. La séquence de Queen Sugar me touche, car elle déploie une politique du refus. Hollywood refuse que l’histoire du désir pour la mort des Noir.e.x.s se prolonge au quotidien et en toute banalité. Or, je sens aussi que cette même séquence excède le seul refus, et ouvre un horizon vers un désir qui libère…
Mélancolie noire et désir pour la vie
« Paradoxalement, la multiplicité de la perte devient le terrain du survivre. Contrairement à l’approche freudienne, elle ne mène pas au suicide mental. Elle oblige le Noir à résister au déclin, à révérer la vie en luttant contre tout ce qui s’évertue à la profaner. »
Nathalie Etoké, 2010, Melancholia Africana. L’indispensable dépassement de la condition noire, Éditions du Cygne, p. 28
Août 2022. J’écris ce texte avec difficulté. Je cherche les mots justes, ceux qui pourraient venir orienter une relation non-morbide à la multitude de vies noires injustement interrompues. « Il est mort et personne ne dit rien sur comment cet homme a vécu » : les mots de Hollywood témoignent d’un sentiment bien trop connu dans la diaspora noire, de ce désir impossible, celui d’être en relation avec une vie alors que cette dernière n’est plus. Il m’apparaît intéressant de lier la séquence de Queen Sugar à ce que Nathalie Etoké appelle la Melancholia Africana, et Nana Adosu Pokei appelle la Black Melancholia. La mélancolie, selon l’approche psychanalytique freudienne, désigne une pathologie, ou du moins un sentiment de tristesse, un vague à l’âme dont l’origine exacte reste inconnue et se dérobe à la conscience.
Repensée depuis l’expérience diasporique noire, le concept prend une autre teneur. Comme l’écrit Nathalie Etoké (2010, p.28), il désigne « un état affectif à la fois collectif et individuel, public et intime » qui renvoie à « un rapport au monde et à soi inéluctablement lié à la perte ». Il y a les pertes causées par l’histoire du colonialisme et de l’esclavage : la perte de l’autonomie, des territoires, de la dignité, la perte des racines, de la culture, de la religion de la langue, l’impossible retour aux sources, la dispersion des liens de parenté à travers les continents. Il y a les pertes causées par l’héritage de cette histoire : la perte par assassinat militaire et policier, par noyade en mer, par négligence ou indifférence médicales, par intoxication de l’air et du sol, par précarité économique, par incarcération en masse. Il y a la perte du chez soi, la difficulté à maintenir des liens familiaux et amicaux lorsque l’on est dispersé.x.s sur la planète. La perte de repères et de sens qu’engendre la vie dans des sociétés centrées sur les normes du capitalisme et de la blanchité.
Il y a la perte de nos histoires. Dans l’essai iconique de 2008, « Venus in two Acts », Saidiya Hartman témoigne d’un sentiment d’impuissance face aux archives déshumanisantes de l’esclavage. C’est uniquement par l’angle de leur perte que l’on peut y déceler l’existence – et très rarement le nom – de celleux qui furent esclavagisé.e.x.s . Et cette perte, relatée depuis la perspective des ravisseurs, émerge dans les archives dans des termes comptables, comme un manque à gagner pour leur opération de vente, d’exploitation et d’appropriation. Écrites par les dominants, les archives sont des « catacombes ».
En somme, l’expérience diasporique noire est marquée par l’enchevêtrement vertigineux d’une multitude de pertes. C’est vertigineux d’avoir à apprendre les noms des nôtres une fois qu’i.elle.x.s ne sont plus, de savoir que d’autres noms viendront s’ajouter dans le futur. C’est vertigineux de buter sur l’impossibilité d’avoir accès à l’archive digne de l’épaisseur et de la richesse de nos vies. C’est à ces vertiges que répond la mélancolie noire. La mélancolie freudienne émerge d’un sentiment de perte qui se dérobe à la conscience. La mélancolie noire, elle, surgit d’un magma de pertes bien présent dans notre conscience mais qui, de par son ampleur et sa teneur, se dérobe à notre connaissance.
Moi aussi, je suis émue et mue par la mélancolie noire. Je pense à mes ancêtres haïtiens, à leurs vies marquées par l’histoire de l’esclavage et du génocide des indigènes dont les récits précis m’échappent. Je pense à tous les noms que j’ai scandés ces trois dernières années dans les manifestations pour les vies noires et contre les violences policières organisées par une coalition de collectifs en Suisse romande (Voir Image 2) [4]. Je pense à Nzoy, Mike Ben Peter, Hervé Mandundu, George Floyd, Sandra Bland, Breonna Taylor, Adama Traoré, Lamine Dieng, Lamin Fatty… je pense à tous les noms que j’oublie ou que je ne connais pas. J’ai conscience de ces pertes, mais je ne sais pas comment celleux que nous avons perdu.e.x.s ont vécu, aimé, résisté. Je sais qu’il n’y a que peu de traces de leur vie dans les archives accessibles au public. Je sais que ces traces laissées par les médias mainstream ou les réseaux sociaux perpétuent la violence faite à ces vies par un cadrage sensationnaliste voire criminalisant. Je suis mue et émue par une conscience ample de la perte de vies qui se dérobent à ma connaissance.
Mais je suis aussi mue et émue par la certitude suivante. Avant d’être injustement interrompues, ces vies ont résisté, désiré, ressenti de la joie, cultivé des relations. Elles ont, de tout temps, pris soin des leurs, travaillé à faire persister la vie noire. Et cette persistance a généré ma vie. J’ai conscience que je suis enchevêtrée à d’innombrables autres vies noires, passées et présentes. Et cette conscience nourrit le désir profond d’être dans une relation radicalement non-extractive, non instrumentale avec ces vies. Je reconnais ce même désir chez Hollywood lorsqu’il se demande comment son frère a vécu ou chez Saidiya Hartman lorsqu’elle cherche une forme narrative qui déjoue la violence des archives-catacombes. Face à une vie qui ne compte médiatiquement et politiquement qu’au moment de son interruption, face à un nom qui circule viralement accolé au mot « mort », nous nous « sentons d’une certaine manière ». Nous sommes décalé.e.x.s, désaligné.e.x.s, hors cadre. Notre cadre à nous c’est la libération noire. C’est le désir pour la vie, le désir surgi de notre conscience intense de la perte tout comme de notre gratitude immense pour la persistance des vies noires.
Prendre soin de nos vies
« – Tu voudrais toujours qu’il soit là avec nous ?
– Oui, mais il est là.
– Par son esprit ?
– Oui…
– On avait l’habitude de manger ensemble chaque soir avant que j’aille au lit, et mon papa me brossait les dents.
– Si tu pouvais dire quelque chose à ton papa, qu’est-ce que tu lui dirais ?
– Je lui dirais tu me manques et je t’aime. »
Gianna Floyd, déclaration d’impact de la victime, NBC news, 25 juin 2021 (traduction de Gaspard Rey)
J’imagine qu’on est en septembre 2322. J’imagine une jeune femme. J’imagine qu’elle vit quelque part sur terre dans un environnement respirable, où elle peut s’épanouir. Elle travaille à cultiver la mémoire noire composée des récits d’une diaspora séculaires dont les archives restent encore dispersées, mais accessibles grâce à une plateforme digitale de savoir planétaire ouvert. Son nom de famille est Floyd. Elle sait que c’est un nom connu. Elle connait l’histoire de ses ancêtres, notamment de celui dont le prénom était George. Sur la plateforme, elle a trouvé des photos de ce dernier, souriant, de sa famille, des témoignages sur comment il vivait, sur ce qu’il faisait. Elle a vu les photographies des millions de personnes qui ont scandé son nom, qui se sont mises en mouvement pour dénoncer l’interruption injuste et inacceptable de sa vie. Elle chérit particulièrement les mots de Gianna, la fille de George, qui raconte comment tous les soirs son papa s’assurait qu’elle se brosse les dents. Ces récits et ces images lui donnent de la force, c’est grâce à ces vies passées qu’elle est là, sur terre.
J’avais prévu d’écrire un texte court en écho au trouble et au désir de Hollywood dans Queen Sugar. J’avais prévu de faire sens des effets néfastes d’une expression virale et morbide, de comprendre pourquoi, tout comme Holywood, je désirais tant savoir comment George Floyd a vécu. Je me retrouve à conclure par un exercice de spéculation fictive. Écrire m’a fait prendre la mesure du désir pour la vie cultivée dans les mouvements artistiques, intellectuels et politiques de la diaspora noire. Un tel désir exige le soin des vies qui ne sont plus, de celles qui sont, et aussi de celles qui viendront. Un travail de tous les jours, exigeant et riche. Pouvoir comprendre avec précision les formes de violences qui interrompent nos futurs. Nommer les forces qui causent la mort prématurée des Noir.e.x.s (par exemple Derek Chauvin, la police, le suprémacisme blanc). Prêter attention à nos émotions de colère, de deuil, de solidarité, de refus, de nos douleurs, de notre mélancolie. Et aussi élaborer des visions de transformation radicales qui fassent vivre nos amours, nos rêves, et nos joies. Cesser de dépendre d’archives-catacombes et de récits sensationnalistes et criminalisants. Faire fructifier, par nos mots, nos images, nos médias, des archives de nos vies qui honorent la force et la beauté de notre persistance et de notre épanouissement passés, présents et à venir.
[1] Traduction de Christian Jacquet, proposée dans Judith Butler, 2016, Rassemblement, pluralité, performativité et politique, Paris: Fayard.
[2] Cette conférence historique de trois jours a été organisée par un groupe indépendant d’étudiant.e.x.s en master et en doctorat composé de Noa Ha, Anna Younes, Mahdis Azarmandi, Andrea Meza Torres et Veronica Zablotsky. Elle a donné lieu au livre édité Decolonize the City!Zur Kolonialität der Stadt – Gespräche, Aushandlungen, Perspektiven.
[3] A ce sujet, voir Hortense Spillers, Black, white and in color: Essay on American literature and Culture (2003), Grada Kilomba Plantation memories: Episodes of Everyday Racism (2008), Saidiya Hartman Scenes of Subjection: Terror, Slavery , and Self-making in ninetheeth-century America, et Jovita dos Santos Pinto “Spuren. Eine Geschichte Schwarzer Frauen in der Schweiz.” In: Berlowitz, Shelley; Joris, Elisabeth; Meierhofer-Mangeli, Zeedah (éds.) Terra incognita? Der Treffpunkt Schwarzer Frauen in Zürich (p. 143-185). Zürich: Limmat Verlag.
[4] Voici une liste non-exhaustive des événements politiques pour les vies noires qui ont été organisé par des coalition de collectifs en Suisse romande (tels que Outrage, Kiboko, Faites des Vagues, Amani, AfroSwiss, Justice 4 Nzoy, Justice pour Mike): Manifestation « Black Lives Matter » du 9 juin 2020 à Genève; « Rassemblement contre les violences policières (en mémoire des victimes de discrimination raciales » du 13 juin 2020 à Lausanne; « Manifestation antiraciste contre les violences policières » du 3 juillet 2020 à Genève; « manifestation pour Mike et pour toutes les victimes de violences policières » du 31 octobre 2020 à Lausanne; Manifestation « Justice pour Nzoy » du 2 avril 2022 à Lausanne; « Rassemblement à la mémoire de Mike Ben Peter » du 1er mars 2022 à Lausanne, mobilisation « Justice for Mike Ben Peter » du 3 juin 2023 à Lausanne.